No products
Product successfully added to your shopping cart
There are 0 items in your cart. There is 1 item in your cart.
Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we consider that you are accepting their use if you keep browsing the website.

Médiologie
- New Art Books
- Exhibition catalogue
- Highlights
- Art Book Sale
- Museum's Shop & Gifts
- Bilingual art books and foreign editions
- Children's Books
- Art History
- Painting
- Architecture
- Sculpture
- Drawing & Engraving
- Photography
- Contemporary art
- Decorative Arts & Design
- Art Techniques
- Critics
- Entertainment art books
- Civilisations
- Partners Reviews
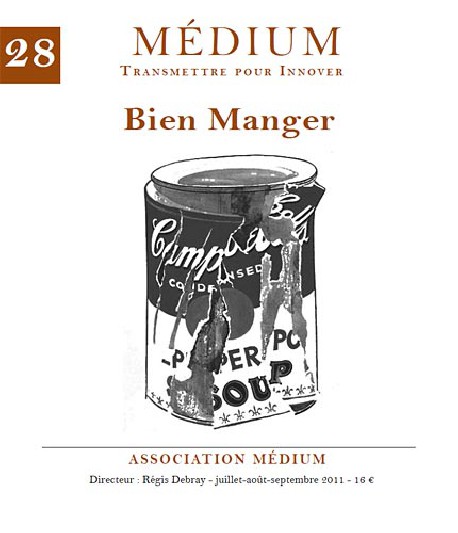
Revue Médium N°28 : Bien manger - juillet-août-septembre 2011
Revue trimestrielle dirigée par Régis Debray. Sommaire : La cuisine est-elle un art ? par Michel Melot ; Qu’est-ce qu’un plat national ? par Michel Erman : Le goût est un tout par Jean-Marcel Bouguereau ; Le superbio par Gaëtan Brulotte ; Cuisine capitaliste, cuisine communiste par Annette Henry ; Halal : la traçabilité par Joanna Freudenheim (...).
Product not available
| Model | 1600000150003 |
| Artist | Médiologie |
| Author | Sous la direction de Régis Debray |
| Publisher | Editions Babylone |
| Format | Broché |
| Language | Français |
| Dimensions | 190 x 170 |
| Published | juillet-août-septembre 2011 |
La cuisine est-elle un art ? par Michel Melot
Bien manger, c’est satisfaire tous les sens et davantage encore : l’être-ensemble, la santé et jusqu’au patriotisme. Et plus s’allongent les médiations, techniques, économiques et sociales de ce bien-être, plus il importe, contre toute évidence, de le déclarer naturel.
Si la cuisine est un art, ce n’est pas un art comme les autres. C’est un art de l’éphémère, consumé dès que consommé. Il partage ce caractère avec d’autres, comme la musique ou la danse, si ce n’est qu’aucune notation, aucun enregistrement ne peuvent garder le souvenir du goût. La cuisine, art de masse par excellence, répétitif à souhait, productible en quantités énormes qu’on a appris à conserver, n’est pas reproductible à distance.
Michel Melot est bibliothécaire, collabore régulièrement à Médium, est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire de l’art et d’histoire du livre (Livre, L’Œil neuf, 2006 ; Daumier, l’art et la République, Les Belles Lettres, 2008).
Qu’est-ce qu’un plat national ? par Michel Erman
Pour mijoter une identité collective, mieux vaut viser le robuste que le sophistiqué. Le plat national est un plat de résistance.
À l’heure de la mondialisation où nous consommons de plus en plus d’aliments délocalisés, où les saveurs variées de l’ethno food tout comme les associations inédites de la fusion food le disputent à l’uniformisation gustative de la fast food, y a-t-il encore quelque pertinence à s’interroger sur la fonction sociale et symbolique que représente un plat national qu’en première approximation on peut définir comme une nourriture associant habitude alimentaire et sentiment d’appartenance ? Le nomadisme, la standardisation et la simplification culinaire ne constituent-ils pas la condition de l’omnivore du XXIe siècle qui a faim de goûts nouveaux mais se rassasie volontiers d’aliments appertisés, précuisinés et sans grande valeur organoleptique, concoctés par l’industrie agroalimentaire ?
Michel Erman est universitaire et écrivain. Derniers ouvrages parus : Le Goût dans tous ses états, Peter Lang, 2009, et Le Bottin proustien, La Table ronde, 2010.
Le goût est un tout par Jean-Marcel Bouguereau
Bien sûr, le goût est en partie inné, mais il s’éduque. D’où des combinaisons infinies, même si nos mille et une saveurs ne disposent que d’un vocabulaire restreint.
« Le goût est ce sens même qui connaît et pratique des appréhensions multiples et successives : des entrées, des retours, des chevauchements, tout un contrepoint de la sensation. » Roland Barthes.
Qu’est-ce que le goût ? Et comment le définir par des mots ? Puisqu’il faut bien partir de quelque chose, partons des sens. La vue nous renseigne sur ce que nous mangeons : la couleur, la forme, la présentation, peuvent nous mettre en appétit ou nous induire en erreur. L’ouïe est un sens secondaire dans la perception des aliments qui apporte certains renseignements, comme le croustillant d’une pastilla marocaine ou simplement celui, plus quotidien, de la croûte de pain. Quant à l’odorat, c’est notre sens le plus primitif mais aussi le plus subtil, qui nous révèle des milliers d’arômes par voie directe ou indirecte. L’homme est doté d’une machinerie olfactive remarquable. Si nos performances demeurent limitées, c’est que nous ne cultivons pas ce fabuleux potentiel. Sentir les aliments précède la mise en bouche et nous renseigne sur leur odeur. On imagine les premiers hommes renifler de possibles nourritures. Est-ce un hasard si, dans les années 60, des recherches menées par le professeur Lipsitt ont permis de démontrer qu’il existe des capacités de détection et d’apprentissage des odeurs chez le nouveau-né ? Même in utero, le système olfactif du foetus est un des premiers sens à se mettre en place, entre onze et quinze semaines ! L’olfaction rétronasale permet de percevoir les molécules odorantes qui se dégagent lors de la mastication et de la déglutition. Un nez « bouché » suite à un rhume réduit considérablement la faculté de goûter, car cela empêche la circulation de l’air vers la cavité rétronasale et donc l’identification des arômes. Dans les deux cas, les molécules odorantes stimulent les récepteurs des cellules nerveuses (neurones) de la muqueuse olfactive située dans la cavité nasale.
Jean-Marcel Bouguereau est journaliste et gastronome. Pour la troisième fois, il a fait partie, en 2009, du jury français chargé par le magazine anglais Restaurant de désigner les cinquante meilleurs restaurants du monde.
Le superbio par Gaëtan Brulotte
Sous l’étiquette « bio », on trouve deux sortes de nourritures. D’un côté, face aux nouvelles exigences des consommateurs et des pouvoirs publics, l’industrie alimentaire fait de nécessité vertu. De l’autre, on remet en cause les modèles industriels. Plus bio que bio : le « superbio ».
Associée à la Grecque Déméter, Cérès était à Rome la déesse de l’agriculture, des moissons et de la fertilité. Quelle serait la nouvelle divinité aujourd’hui dans ce domaine ? Le bio, assurément, qui est devenu une valeur porteuse, presque déifiée, dans l’univers alimentaire, où il semble servir de pont entre des pratiques séculaires éprouvées et une agriculture durable. Si ce bio a trouvé sa place dans les grands circuits de distribution, sa popularité s’accompagne d’exigences accrues chez les consommateurs, dont certains recherchent, au-delà des seuls rayons bio des supermarchés, deux qualités supplémentaires : la fraîcheur et, ce qui en est la garantie, la production locale, satisfaisant ainsi à un souci écologique et à un engagement citoyen envers l’agriculture paysanne. C’est dire que ce que l’on essaie d’unifier sous le même label AB recouvre, en fait, deux formes d’agrobiologie bien différentes : l’une applique de façon minimale la lettre du cahier des charges bio, et, poussée à la production intensive, s’intègre de plus en plus à l’industrie existante, à laquelle elle se soumet ; l’autre, rebelle au système établi mais fidèle à l’esprit des grands principes, travaille en amont à transformer les modèles industriels par des procédés fondés sur des écosystèmes naturels et des stratégies socio-économiques alternatives. Cette seconde forme, je propose de la nommer superbio. Comment les valeurs et l’imaginaire social de ce superbio se construisent-ils et circulent-ils ? Prenons quelques exemples en France, au Canada et aux États-Unis.
Gaëtan Brulotte est professeur à l’université de Tampa (États-Unis) et écrivain. Dernier ouvrage paru : La Nouvelle québécoise, Hurtubise, 2010.
Cuisine capitaliste, cuisine communiste par Annette Henry
Pas de discours plus idéologique que celui des manuels de cuisine. Deux manuels parmi les plus répandus dans les années 30, en France et en URSS, en apportent la démonstration.
Les livres de cuisine en disent parfois plus long que prévu. Ils donnent envie de manger, mais ils donnent aussi envie de penser. L’histoire d’une société, de ses rêves et de ses failles peut s’y lire presque sans efforts, et les orientations politiques s’y révéler dans les moindres recoins. Cette littérature, jugée bien anodine par ceux qui ne la lisent pas, fourmille d’observations curieuses. Elle nous montre sans en avoir l’air l’état de l’économie d’un pays, avec les périodes d’opulence ou de pénurie, elle nous parle de la santé, des classes sociales, de la structure familiale, de la condition féminine, de l’amour, de la morale, de l’ouverture ou au contraire de la fermeture au monde. Les évolutions sont aisément repérables, car si dans un même pays les recettes proprement dites changent peu selon les époques, le discours qui les accompagne change beaucoup. Deux exemples, l’un français, l’autre soviétique, nous renvoient à des faits de société bien caractéristiques.
Annette Henry est docteur en études slaves, spécialiste de la photographie soviétique. Elle prépare, en collaboration avec la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine, une exposition sur les années de la perestroïka.
Halal : la traçabilité par Joanna Freudenheim
La question de l’alimentation halal conduit à s’interroger plus généralement sur la provenance des aliments, mais aussi sur leur parcours entre production et consommation, dans l’observance des lois sociales, hygiéniques et religieuses.
Prenons deux plats : l’un provient d’un abattage halal, l’autre, d’un abattage ordinaire. Est-il vraiment possible de faire la distinction entre les deux ? Au cœur de la problématique globale de la traçabilité agroalimentaire se pose la question complexe du halal, qui signifie « convenant aux lois de l’islam », en d’autres termes, il s’agit de ce qui est licite pour un musulman. L’alimentation halal nous oblige à nous interroger non seulement sur la provenance des aliments, mais aussi sur le parcours qui sépare leur production de leur consommation, lequel relève du respect de lois sociales, hygiéniques et religieuses. En France, est-ce toujours possible ? Sinon, quelles en sont les conséquences (pour la société) ?
Joanna Freudenheim est diplômée en études proche-orientales de la Washington University de Saint Louis, dans le Missouri (États-Unis). Elle s’intéresse aux rapports entre alimentation, politique et religion en Europe de l’Ouest et dans le monde arabo-musulman.
Le plateau-repas par Pascal Lardellier
Dans les réunions d’entreprise, les congrès, en voyage ou devant la télé, le plateau-repas est le symbole même de ce que l’on n’appelle plus cuisine mais « fooding ». Et c’est encore en avion qu’il affiche le mieux ses vertus et ses vices.
Dans le film Fight Club de David Fincher (1999), le plateau-repas pris en gros plan apparaît comme le symbole de l’uniformisation et de la monotonie de la vie moderne. Une voix off récite : On se réveille dans un aéroport dont on ne sait même pas le nom. Si on se réveillait à une heure différente, dans un endroit différent, pourrait-on se réveiller dans la peau d’une personne différente ? À chaque nouveau voyage, toute une vie en miniature : sachet de sucre à usage unique, gobelet de crème à usage unique, noix de beurre à usage unique, kit-plateau-repas-cordon-bleu micro-ondé…
Pascal Lardellier est professeur de sciences de l’information-communication à l’université de Bourgogne, Dijon. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, il vient de publier Opéra bouffe. Une anthropologie de nos modes alimentaires (Éditions EMS).
Manger des yeux par Pierre d’Huy
Organisée comme une opération militaire, la cuisine à la télévision s’inscrit parfaitement dans la « télé-réalité ». Comme tant d’émissions du genre, elle propose un illusoire substitut à la transmission : des années, voire des siècles, d’éducation s’y trouvent compactées dans le temps minuté d’une émission.
Dans le noir est un restaurant parisien où l’on dîne dans le noir absolu. Les serveurs sont aveugles. On se surprend au fil du repas à démultiplier sa perception des goûts et des odeurs pour compenser le sens de la vue dont on se trouve privé. À bien y regarder, ce qui se produit au cours d’une émission de cuisine télévisée, c’est exactement le contraire. Le contrat télévisuel d’une émission télévisée de cuisine consiste à apprendre à ne manger qu’avec ses yeux. Sans l’usage du toucher, de l’odorat et du goût, comment transmettre l’art culinaire et faire partager les sensations ? C’est sur cette étonnante adaptation à un medium audiovisuel d’une histoire de papilles, de fumet et de contact que nous nous proposons de nous pencher.
Pierre d’Huy est directeur du MIP, école de commerce du groupe EDHEC, maître de conférences associé en information et communication au CELSA Sorbonne Paris IV, et directeur de PH8, société de conseil en management de l’innovation. Dernier ouvrage paru : L’imagination Collective, Éditions Liaisons sociales.
Le refus de paître. À propos de « La faim » de Knut Hamsun par Pierre Chédeville
Si la gastronomie pare des séductions de l’art une triviale nécessité, endurer la faim peut être une façon de s’en affranchir, désespérément. L’écrivain maudit met ici en scène un jeûneur sublime, parfaite antithèse du consommateur moderne.
Un homme, fiévreusement, arpente sans fin les rues de l’ancienne Oslo, Christiania. La faim le tenaille et le conduit à la mort à petit feu. Nous le suivons, péniblement, dans ses pérégrinations affamées et désespérées. Dans quelle nasse infernale est-il piégé, de quelle malédiction est-il la victime ? N’y a-t-il vraiment rien à faire, est-il définitivement perdu ? D’où vient le sentiment d’irréalité de ce roman ? Pourquoi nous met-il mal à l’aise ? Pourquoi, à l’instar du héros en proie à l’inanition causée par un jeûne forcé, finissons-nous par perdre nos repères ?
Pierre Chédeville a une double formation en management et en littérature. Présent dans le monde de l’entreprise, où il est spécialiste du domaine bancaire, il n’a cependant pas cessé de questionner les grands textes pour essayer d’éclairer de manière décalée le monde contemporain.
Pour une Université populaire du goût par Michel Onfray
Après le succès de son Université populaire de Caen, Michel Onfray a voulu lancer dans sa ville d’Argentan une Université populaire du goût. Que l’expérience ait connu des débuts difficiles n’empêche pas d’en rappeler ici les ambitions généreuses et savoureuses. Ce texte est tiré de l’introduction de « Ce qui n’est pas donné ».
Michel Onfray est docteur en philosophie, auteur d’une cinquantaine d’ouvrages et créateur de l’Université populaire de Caen en 2002, puis de l’Université populaire du goût à Argentan, sa ville natale, en 2006.
BONJOUR L’ANCÊTRE
Jean Anthelme Brillat-Savarin, par Michel Erman
Il est des écrivains plus consommés que leur oeuvre. C’est le cas de Brillat-Savarin, dont la Physiologie du goût, publiée anonymement en 1825, peu avant sa mort, est souvent évoquée, parfois citée de façon fragmentaire, mais, en dépit de la reconnaissance et du succès obtenus au XIXe siècle, qui faisaient dire à un Balzac qu’on tenait avec ces « méditations de gastronomie transcendantales » une prose digne de La Rochefoucauld, rarement lue aujourd’hui.
OBJETS
Le micro-ondes et le congélo, par Paul Soriano
Soufflant le chaud et le froid, ces deux dispositifs techniques s’inscrivent, culturellement, dans l’interminable guerre des sexes. Si le frigo, autant que la cuisinière, appartient sans discussion au règne féminin, le congélo connecté au micro-ondes en affranchit le mâle. À quel prix ?
Paul Soriano, après avoir dirigé un institut de prospective, est actuellement chargé de mission à la direction de la stratégie du groupe La Poste.
Comité de rédaction :
Directeur : Régis Debray
Rédacteur en chef : Paul Soriano
Secrétariat de rédaction : Isabelle Ambrosini
Comité de lecture : Pierre-Marc de Biasi ; Jacques Billard ; Daniel Bougnoux ; Pierre Chédeville ; Jean-Yves Chevalier ; Robert Damien ; Robert Dumas ; Pierre d’Huy ; Michel Erman ; Françoise Gaillard ; François-Bernard Huyghe ; Jacques Lecarme ; Hélène Maurel-Indart ; Michel Melot ; Louise Merzeau ; Antoine Perraud ; France Renucci ; Monique Sicard.
Recently viewed items
-

02.03.2026
Exposition Les énergies de la terre Read more





