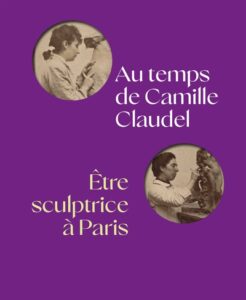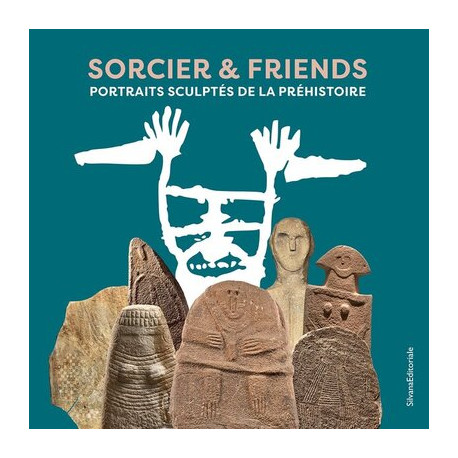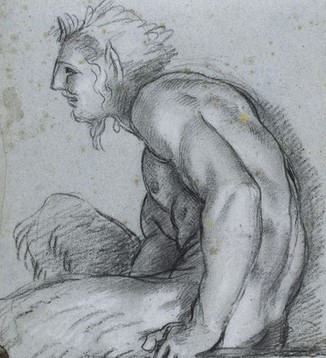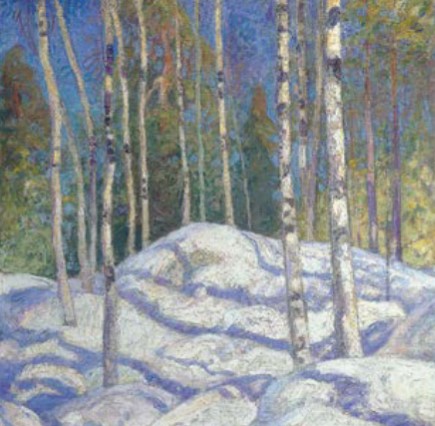Aucun produit
Produit ajouté au panier avec succès
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Afin d'optimiser votre expérience de navigation, ce site utilise des cookies. En navigant sur ce site, vous en acceptez l'usage.

Exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris
Une exposition présentée au Musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine (13 septembre 2025 - 4 janvier 2026)
Publié le Wednesday 08 October 2025
L'exposition met en lumière le réseau artistique féminin qui entoura Camille Claudel, depuis son apprentissage dans le Paris de la fin du XIXe siècle jusqu’à son internement en 1913.
Depuis sa redécouverte dans les années 1980, l’œuvre de Camille Claudel a été mise en lumière à travers de nombreuses expositions, donnant l’impression d’un talent isolé, presque miraculeux. Pourtant, dès son arrivée à Paris à l’automne 1880, la jeune Claudel – alors âgée de 16 ans – rejoint une scène artistique déjà marquée par la présence de sculptrices.
Pour ces femmes, l’accès à la formation et à la reconnaissance demeurait toutefois difficile. Les stéréotypes, l’exclusion des femmes de l’enseignement artistique, notamment à l’École nationale des Beaux-Arts, ainsi que les contraintes économiques de la sculpture traditionnelle (coût du bronze ou du marbre, recours à des ouvriers) constituaient autant d’obstacles à leur entrée dans cette discipline.
La première section de l’exposition s’attache à celles qui, malgré tout, parviennent à poursuivre leur vocation et à s’imposer sur la scène parisienne, selon des parcours et des stratégies variés. Leurs œuvres sont reçues au Salon et saluées par la critique ; plus rarement, certaines obtiennent des commandes publiques. Marie Cazin (1844-1924), Charlotte Besnard (1854-1931) ou encore Jeanne Itasse (1855-1941) ont ainsi évolué à l’abri de la renommée d’un époux ou d’un père artiste.
D’autres, comme Laure Coutan-Montorgueil (1855-1915), issue d’une famille d’artisans, et Marguerite Syamour (1857-1945), élevée dans un milieu intellectuel progressiste, ont connu les difficultés liées à la pratique de la sculpture sans subir d’opposition de leur entourage.
Un cas particulièrement remarquable est celui de Blanche Moria (1859-1926), qui, bien que née dans une famille de commerçants, est reconnue comme « artiste-statuaire » à son décès.
La deuxième partie de l’exposition s’ouvre sur une période de compagnonnage artistique entre Camille Claudel et ses contemporaines à l’Académie Colarossi. À la fois école privée et atelier libre, l’Académie est réputée pour son enseignement mixte et ses cours de sculpture d’après modèle. Claudel y étudie aux côtés d’autres jeunes artistes femmes, françaises et étrangères, principalement britanniques et scandinaves : Madeleine Jouvray (1862-1935), Jessie Lipscomb (1861-1952), Sigrid af Forselles (1860-1935) ou encore Carolina Benedicks-Bruce (1856-1935).
Grâce au soutien de son père et associée à certaines de ses camarades de l’Académie, Camille Claudel loue un atelier rue Notre-Dame-des-Champs. Elle le partage avec Ghita Theuriet (1862-1911), Laetitia von Witzleben (1849-1923) et les sculptrices Sigrid af Forselles, Madeleine Jouvray et surtout Jessie Lipscomb.
La troisième séquence de l’exposition aborde les relations des femmes sculpteurs avec Auguste Rodin, entre transmission, influence et désir d’émancipation. À l’automne 1882, Rodin remplace Alfred Boucher, parti pour Florence, afin de superviser l’atelier de Claudel rue Notre-Dame-des-Champs. Ne se considérant pas comme un professeur au sens traditionnel du terme, Rodin forme ses « élèves » par la pratique. Travaillant côte à côte dans l’atelier, les artistes emploient les mêmes modèles, échangent et se confrontent parfois dans le traitement et la réalisation de sujets semblables. Autour de Rodin, ces sculptrices empruntent la voie du symbolisme, livrant des représentations sans fard du corps vieillissant, souffrant ou mourant.
L’exposition se clôt sur l’« après-Rodin ». Après leur rupture en 1893, Camille Claudel cherche à tout prix à se libérer de l’influence du maître. L’atelier devient un espace isolé où Claudel s’inspire uniquement de ses expériences personnelles.
Souvent comparées à Camille Claudel par la critique, Anna Bass (1876-1961), Jane Poupelet (1874-1932) et Yvonne Serruys (1873-1953) appartiennent à une nouvelle génération d’artistes qui rejettent l’expressionnisme et le symbolisme rodiniens, elles adoptent un regard plus direct et intime, qui révèle une sensibilité moderne. Poupelet et Serruys figurent ainsi aux côtés de Claudel dans une exposition d’art français organisée à Zurich, en février-mars 1913, au moment même où cette dernière disparaît de la scène artistique. Bien que reconnues de leur vivant, elles seront peu à peu éclipsées par l’émergence des avant-gardes.
Informations pratiques :
• Catalogue d'exposition Au temps de Camille Claudel, être sculptrice à Paris, éd. Silvana
• Musée Camille Claudel : 10 rue Gustave Flaubert - Nogent-sur-Seine
• Horaires : ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 17h
• Plein tarif : 10 €, Tarif réduit : 6 €.
• Accès en train : à 1 h de Paris depuis la gare de l’Est, puis 10 mn à pied de la gare au musée. Accès en voiture : à 1 h 20 de Paris par la nationale 4 ou par l’A4 et la D231. À 1 h de Troyes par la D619. À 1 h 45 de Reims par la D95. À 45 mn de Sens par la D939. À 20 mn de Provins par la D619.
Commissariat d'exposition : Cécile Bertran, Directrice du musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Hélène Jagot, Directrice des musées et Château de Tours. Sophie Kervran, Directrice du musée de Pont-Aven.
 Imprimer cet article
Imprimer cet article
Dans la même rubrique
Expositions en régions
Voir tous les articles de la rubrique Expositions en régions